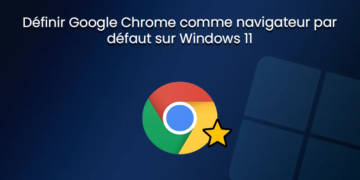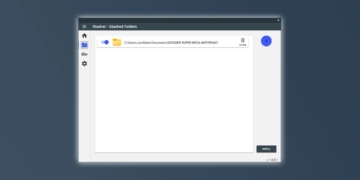[ad_1]
Jérôme Gautié est professeur d’économie à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Il revient sur les origines historiques du salaire minimum et son importance sociale et symbolique.
Dans quel contexte le salaire minimum a-t-il été créé en 1950 ?
Les prix et les salaires étaient contrôlés par l’État depuis 1939. Lorsqu’il fut décidé de revenir à la liberté des prix, les syndicats arguèrent que les salaires ne pouvaient rester bloqués, au risque d’une perte de pouvoir d’achat. La loi de 1950 rétablit la liberté de négociation collective, et crée parallèlement le premier salaire minimum interprofessionnel garanti (smig). Elle est pensée comme un garde-fou pour éviter toute exploitation là où les syndicats sont faibles ou inexistants. Il faut alors fixer son niveau.
Il y a une grande peur du gouvernement, déjà à l’époque, qu’on cause de l’inflation ou qu’on déstabilise l’économie si elle est trop élevée. Mais doit-il s’agir d’un simple salaire minimum ou d’un salaire vital ? Et qu’est-ce que la pudeur ? Patronat et syndicats s’entendent sur le budget alimentation, pas sur le reste, avec des discussions acharnées sur le nombre de savons, de costumes ou de chemises de nuit nécessaires, ou encore les frais d’électricité ! En fin de compte, c’est le gouvernement qui a décidé.
Pourquoi le salaire minimum est-il devenu le salaire minimum en 1970 ?
Lors des grèves de 1968, l’une des premières revendications syndicales fut la revalorisation du salaire minimum. Ce dernier baisse fortement par rapport au salaire moyen : sur la période 1951-1967, son pouvoir d’achat n’augmente que de 25 % contre 103 % pour le second, porté par la croissance et les gains de productivité. Le protocole de Grenelle enregistre une augmentation de 35 % du salaire minimum. Les employeurs, effrayés, ont accepté presque sans discussion, alors qu’ils avaient refusé 3% quelques mois plus tôt ! Pour éviter tout nouveau décrochage, le mode de calcul a été modifié à partir de 1970, avec le passage au Smic : le salaire minimum interprofessionnel de croissance sera partiellement indexé sur le salaire horaire moyen d’un ouvrier.
Avec l’inflation, le salaire minimum rattrape les bas salaires, certains prônent sa désindexation, d’autres préconisent au contraire d’indexer tous les salaires. Cette question a-t-elle déjà été posée ?
Dès l’origine, le lien entre le salaire minimum et les minima des conventions collectives a été au cœur des débats. La grande crainte du gouvernement lorsqu’il adopte le salaire minimum est que tous les salaires augmentent dans la même proportion. C’est ce que la CGT a toujours prôné. Mais la loi de 1970 l’interdit. C’est un peu le paradoxe aujourd’hui : face aux augmentations successives du salaire minimum, le gouvernement pousse les branches à négocier pour ne pas être rattrapées. Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui le salaire minimum est devenu un pilier fondamental du modèle social français. C’est un contrat social, un « salaire de civilisation », disaient certains lors de sa création. Pour s’assurer que celui qui travaille ne décroche pas. Revenir en arrière est symboliquement impossible et serait politiquement très coûteux.
[ad_2]
Source link