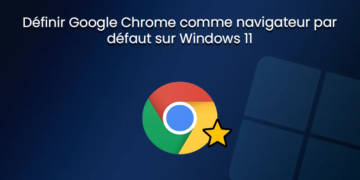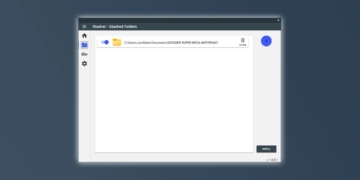[ad_1]
Dans les entreprises comme dans la fonction publique, l’accès des femmes aux postes de direction n’a jamais été un long fleuve tranquille. En 2011, la loi Cope-Zimmermann a été adoptée, qui établit des quotas de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance. Un an plus tard, la loi sur la fonction publique supérieure de Sowade a été adoptée. Marie-Anne Barba-Layani, secrétaire générale du ministère de l’Économie et des Finances, revient sur les événements qui se sont déroulés ces dernières années, notamment à Bercy.
Dix ans après l’adoption de la loi Sowade, qui visait à nommer davantage de femmes aux postes à responsabilité dans la fonction publique, leur situation s’est-elle améliorée ?
Il est évident. Cette loi de 2012 est extrêmement ambitieuse. Il demande que 40 % de femmes soient nommées à des postes de direction, correspondant en partie aux comités exécutifs des entreprises. Bien sûr, le ministère des Finances avait un énorme retard dans ce domaine. L’histoire l’explique. Jusqu’en 1974, par exemple, les femmes ne pouvaient pas travailler à l’Inspection générale des finances. Le Ministère était un milieu d’hommes, comme tous les lieux de pouvoir ou d’argent.
A mon arrivée à Bercy en 1993, mon patron m’avait prévenu : « Tu verras le plus beau groupe de costards gris de ta vie ! Dans les locaux que je fréquentais à cette époque, dans les locaux du Club de Paris [où se négocient des solutions pour les Etats endettés], le chemin le plus court qui reliait les deux pièces où l’on travaillait, passait par les toilettes des hommes… J’ai marché, en regardant la ligne bleue des Vosges ! Collaborer avec des femmes était vraiment inhabituel.
Comment cela s’est-il manifesté dans votre carrière ?
Lors de mon stage à l’Ecole Nationale Supérieure de Gestion (ENA), le préfet, qui m’accueillait, m’a appelé. « ma cocotte ». Mais je pense qu’il l’a fait par affection paternaliste plutôt que par misogynie. Lorsque j’étais directeur adjoint au cabinet du premier ministre de 2010 à 2012, il m’est arrivé de l’accompagner à Londres. Alors qu’il dîne seul avec son collègue, le personnel est placé dans une autre pièce pour partager un repas avec des conseillers britanniques. Quand mon alter ego m’a trouvé assis au milieu en face de lui, il a semblé complètement perdu. Il m’a demandé qui j’étais, si je m’occupais de la fraternité ! Il ne comprenait pas qui était cette gentille femme qui avait eu l’audace de s’installer en ce lieu…
Un haut fonctionnaire européen, avec qui j’avais des désaccords, m’a dit un jour qu’il valait mieux pour moi d’être à la maison, d’élever des enfants… A Bercy, le chef de service, qui m’a croisé dans le couloir et a remarqué ma grossesse très tardive, me lança en souriant : « Vous nous quittez ? » En fait, pendant longtemps dans ce ministère, on a pensé que la tâche était trop lourde pour une femme, ou qu’elle devait renoncer à avoir des enfants. Les générations précédentes ont peut-être dû choisir. Pas le mien.
Il vous reste 53,53% de cet article à lire. De plus uniquement pour les abonnés.
[ad_2]
Source link