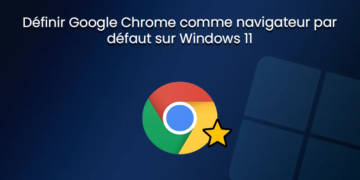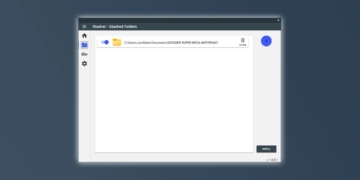[ad_1]
Les grèves des raffineries TotalEnergies et Esso-ExxonMobil ont mis en lumière une question peu évoquée dans le débat public, mais centrale dans le déroulement du conflit et sa difficile résolution.
De nombreux commentateurs, mais aussi des personnalités politiques, semblaient surpris qu’un conflit salarial puisse démarrer et se poursuivre dans une entreprise alors qu’un accord avait été signé à ce sujet par des syndicats majoritaires au niveau du groupe.
Ces réactions révèlent d’abord une certaine méconnaissance. L’existence d’une convention collective n’entraîne, en droit français, aucune obligation de paix sociale susceptible d’empêcher les organisations non signataires de s’opposer par un mouvement collectif aux mesures ratifiées par la convention collective. Mais surtout, la configuration du conflit est en partie le résultat des multiples réformes du droit de la négociation collective menées ces dernières années.
Depuis les années 1980, les pouvoirs publics n’ont cessé de promouvoir la convention collective d’entreprise comme mode de régulation de la relation de travail. La convention collective d’entreprise avant tout. Devant la loi, mais aussi devant la convention collective de branche. Cette dernière, centrale à l’origine dans la structure conventionnelle, a ainsi été progressivement mise de côté, grâce à un mouvement de décentralisation de la négociation collective, orchestré sous l’égide de la promotion de la « norme de proximité » afin de permettre à chaque entreprise d’imposer ses propres pacte social.
« L’entente de groupe est maintenant un instrument puissant entre les mains des chefs de groupe. Cela signifie que la négociation dite de proximité, tant vantée ces dernières années, a perdu du terrain.
Cette tendance a pris une nouvelle dimension avec la loi dite « travail » du 8 août 2016, votée sous le gouvernement de Manuel Valls, et les mouvements sociaux qui l’ont accompagnée. A l’époque, c’est surtout la suppléance de la loi par rapport à la convention collective d’entreprise (l’inversion de la « hiérarchie des normes ») que les opposants avaient identifiée comme un enjeu conflictuel.
Mais le défi est passé à côté d’un autre changement majeur : celui concernant la convention collective de groupe. En 2016, celle-ci a acquis la capacité de s’imposer face à l’accord collectif d’entreprise et de prescrire une norme applicable à tous les salariés des entreprises d’un groupe.
Ces accords ont été appliqués pour la première fois lors de la mise en place des nouveaux comités sociaux et économiques (CSE), remplaçant les comités d’entreprise (CE). Chaque direction de groupe peut donc, lorsqu’elle trouve les majorités syndicales le permettant, conclure un accord visant à harmoniser les statuts sociaux de l’ensemble du groupe. L’accord de groupe est maintenant un instrument puissant entre les mains des chefs de groupe. Cela signifie que la négociation dite de proximité, tant vantée ces dernières années, a perdu du terrain.
Il vous reste 52,85% de cet article à lire. Ce qui suit est réservé aux abonnés.
[ad_2]
Source link