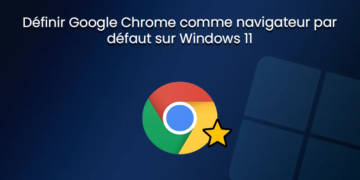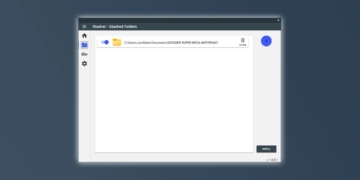[ad_1]
Aorsque la planification publique de la décarbonation est au cœur des débats économiques, les entreprises tentent d’anticiper. Bien qu’elles n’y soient pas formellement obligées, la plupart des entreprises du CAC 40, par exemple, considèrent désormais leurs émissions de gaz à effet de serre comme des coûts. Ils attribuent donc un « prix interne » fictif à tout ou partie des tonnes de carbone qu’ils émettent.
L’idée est que les émissions, ainsi transformées en données financières, les inciteront à privilégier des options d’investissement relativement moins intensives en carbone. L’Etat utilise également un outil similaire pour se motiver à agir : le « jaune » budgétaire, intitulé « impact environnemental du budget », annexé aux projets de loi de finances. Cette tarification volontaire du carbone fait écho à l’obligation réglementaire que certaines entreprises ont de payer, cette fois pour de vrai, leurs émissions.
En Europe mais aussi aux États-Unis ou en Chine, par exemple, de nombreuses entreprises appartenant à certains secteurs d’activité doivent payer des taxes ou acheter des quotas d’émission. Historiquement, les prix internes du carbone des entreprises ont souvent précédé cette tarification par les pouvoirs publics.
Aucun effet sur le choix des investissements
Au-delà du fait qu’ils peuvent préparer les entreprises à devoir payer la pollution engendrée, à quoi servent ces prix internes fictifs, cet outil comptable et financier très prisé par les agences de notation extra-financière ? Une recherche menée en immersion dans une grande entreprise française du secteur de l’énergie (« Gouverner par le signal prix ? Sur la performativité des prix internes du carbone dans les entreprises », thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Paris-Dauphine-PSL) montre que disposer de cet instrument ne signifie pas qu’on l’utilise pour réduire les émissions.
Dans cette grande entreprise, le calcul du prix interne du carbone, utilisé depuis une quinzaine d’années, a certes progressivement sensibilisé les salariés au risque climatique, mais une seule fois a-t-il eu un impact concret sur les choix d’investissement, et là encore, le projet concerné avait de nombreux défauts qui rendaient son approbation illusoire.
Sur cette période, la relative décarbonation de l’entreprise a en effet résulté d’une planification, avec des prises de décision volontaristes comme l’arrêt des investissements dans le charbon, la mise en place de normes internes, notamment des objectifs d’efficacité énergétique, ou des acquisitions d’entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables. énergies et efficacité énergétique.
Il vous reste 30,6% de cet article à lire. Ce qui suit est réservé aux abonnés.
[ad_2]
Source link