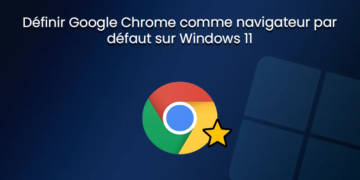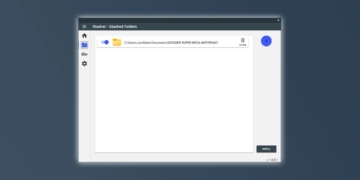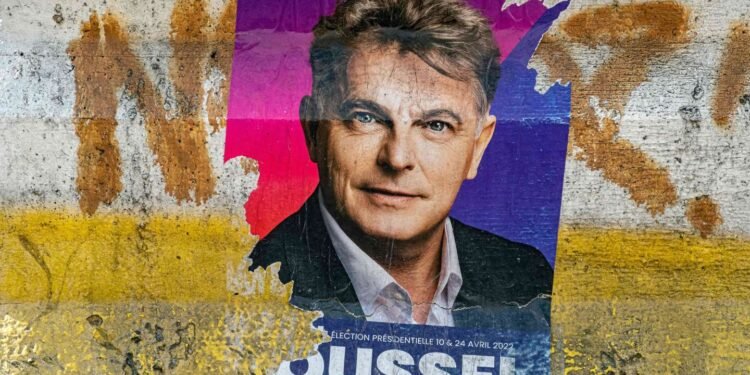[ad_1]
En lançant une nouvelle polémique opposant la « gauche ouvrière » et la « gauche des avantages », le secrétaire national du Parti communiste a réveillé les vieux démons de la gauche, tiraillés entre la défense des travailleurs et l’émancipation historique du travail. La polémique révèle ainsi une fracture historique de la gauche entre compromis capitaliste et rupture communiste.
Simples invectives, attaques ad hominem, guerres d’ego, divergences stratégiques ou fracture profonde ? Les affrontements successifs entre Fabien Roussel et la députée verte Sandrine Rousseau, qu’ils portent sur le virilisme carnivore ou le rapport au travail, ne se limitent pas à la confrontation d’un folklore communiste et réactionnaire à l’ultra-modernité gauchiste, car ils ont une histoire.
Le droit au travail, avec l’ouverture des ateliers nationaux, n’est-il pas la grande victoire (éphémère) du socialiste Louis Blanc (1811-1882) lors de son entrée au gouvernement en 1848 ? Déjà, Louis Blanc s’opposait à un simple « droit à l’assistance », puisque le « droit à la vie » devait ériger le droit au travail en conservation productive de la vie (Socialisme. Droit de travailler1849).
Le statut « historique » du travail
Comment accuser alors Fabien Roussel de fléchir à droite en se revendiquant de la gauche ouvrière ? La lutte historique de la gauche marxiste est celle de la lutte du travail vivant contre le travail mort, des ouvriers contre le capital. Cependant, Karl Marx explique dans son 1844 manuscrits que le communisme se réalise à travers « l’abolition positive de la propriété privée ». La puissance du travail dominée par l’oppression aliénante du capital serait abolie au moment même où la propriété des moyens de production est socialisée, et donc le travail partagé, tout comme l’oisiveté capitaliste éliminée.
Cette conception du travail se heurte néanmoins à des ambiguïtés dans l’histoire du marxisme. Le droit à la paresse revendiqué par Sandrine Rousseau renvoie en effet au titre du célèbre ouvrage de Paul Lafargue de 1880. Le gendre de Karl Marx a alors sonné la charge contre le droit au travail.
« Travaillez, travaillez, prolétaires, pour augmenter la richesse sociale et vos misères individuelles. » Voilà pour Lafargue l’injonction du capitalisme – de droite, dirait-on aujourd’hui –, qui cherche à accumuler des richesses en augmentant toujours plus le surtravail, c’est-à-dire l’exploitation des travailleurs.
Paul Lafargue était-il, comme Sandrine Rousseau, un opposant au communisme ? Dès 1880, il demande aux ouvriers de résister à l’impératif écrasant du travail. La difficulté réside ici dans le statut « historique » du travail : sous le capitalisme, il est encore aliénant, puisqu’il devient la répétition d’un effort brut sous le contrôle du capital, mais il doit devenir doublement libérateur sous le communisme. Doublement parce qu’elle est désormais un élément de la vie démocratique des sociétés vaincues par la tutelle capitaliste, mais aussi un moyen de libérer du temps social disponible. En tentant de réfuter le droit au travail, Paul Lafargue révèle l’ambiguïté historique du marxisme : si, au présent, le travail est aliénant sous la domination capitaliste, il n’en est pas moins un élément nécessaire d’une société communiste en quête d’émancipation. social.
Il vous reste 46,29% de cet article à lire. Ce qui suit est réservé aux abonnés.
[ad_2]
Source link