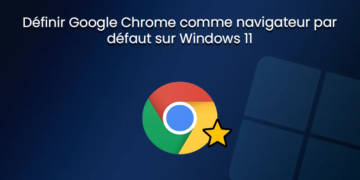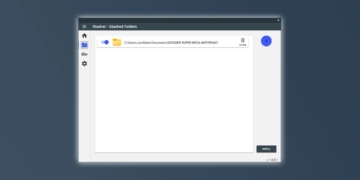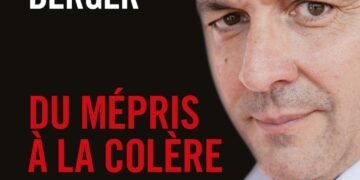[ad_1]
JTrois fictions cinématographiques sorties récemment en France illustrent les maux du travail, à trois moments de son évolution historique. Ordresde Cyril Schäublin, dépeint les débuts du taylorisme à la fin du XIXee siècle dans les manufactures horlogères suisses. À propos de Kim Sohee, de July Jung, examine le travail des téléopérateurs sud-coréens en open space. Entre les deux est inséré L’établide Mathias Gokalp, qui retrace le travail à la chaîne à la fin des années 1960 dans l’industrie automobile.
Le chronomètre et la performance sont au cœur de ces trois histoires. Le travail échappe à ceux qui l’accomplissent. Il est défini, disséqué, orchestré et contrôlé par ceux qui le conçoivent. Ouvriers et employés ne sont que des exécutants, chargés d’appliquer un scénario dont ils ne peuvent déroger sous peine de pénalités et de sanctions, voire d’humiliation. Chaque geste est optimisé, dans l’horlogerie et l’automobile, chaque mot est compté dans les centres d’appels.
Certes, le travail d’aujourd’hui n’est plus celui des années 1870 ou 1970, les conditions de travail ne sont plus les mêmes. Notamment, la saleté et le bruit n’envahissent plus les usines, comme le montre par exemple le documentaire réalisé par Louis Malle aux usines Citroën (Humain, trop humain, 1974). Mais si les décors changent, si les ambiances et ambiances de travail ne sont pas comparables, il n’en reste pas moins un sentiment de continuité.
L’influence du chronomètre persiste, et l’ouvrage, dans son contenu et dans son organisation, repose sur une rupture entre conception et exécution. Ceux qui disent – et pensent – l’œuvre ne sont pas ceux qui l’accomplissent et font face à sa réalisation. Au nom de la productivité et de la rentabilité, l’univers managérial dicte les rythmes et les façons de faire. Penser et faire, dans le monde du travail, appartiennent résolument à deux univers distincts, malgré l’invitation, parfois sincère, à être « force de proposition »s’exprimer et innover.
Frustrations et injustices
En réalité, ceux qui le font se taisent, pour la plupart, ou ne s’expriment qu’à côté et à l’extérieur. Il est frappant de constater le silence qui règne sur l’organisation du travail, l’enchaînement des gestes, et plus généralement les façons de faire dans les usines horlogères et dans les centres d’appels. Non pas parce que les salariés n’ont rien à dire, mais parce qu’ils ne sont que peu écoutés, et peu entendus. Leurs avis ne comptent pas, ou trop peu. Cette pause reste l’une des principales sources de tension, d’inconfort, de pénibilité et d’absurdité dans l’accomplissement du travail quotidien.
Il vous reste 58,08% de cet article à lire. Ce qui suit est réservé aux abonnés.
[ad_2]
Source link