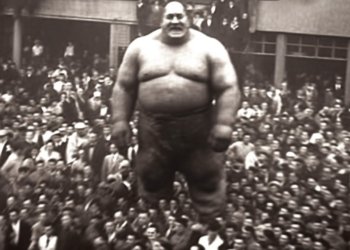[ad_1]
Quand l’État pousse le secteur privé à négocier sur les salaires, il a du mal à être pris au sérieux. La démonstration en est faite, une fois de plus, avec le projet de loi « pour la protection du pouvoir d’achat », que l’Assemblée nationale examine en séance publique à partir du lundi 18 juillet. Le texte cherche à faire pression sur les branches professionnelles qui tardent à ajuster leurs grilles salariales en fonction de l’évolution du salaire minimum. Mais son efficacité est remise en cause, notamment par la gauche, qui y voit un « menace de peau de lapin »selon la formule de Pierre Dharréville, député communiste des Bouches-du-Rhône.
La mesure contestée vise à résoudre un problème qui n’est pas nouveau mais dont l’ampleur s’est récemment accrue. Depuis octobre 2021, le salaire minimum a été augmenté trois fois, atteignant désormais un peu plus de 1 302 euros nets par mois (pour les temps pleins). Ces réajustements successifs ont été décidés conformément à la loi, qui vise à garantir que la rémunération minimale progresse au moins aussi vite que l’inflation.
Mais de nombreuses branches professionnelles sont incapables de suivre le rythme. Sur les 171 suivis par le ministère du Travail, 112 avaient, au 1euh juillet, une convention collective contenant au moins un coefficient de rémunération inférieur au Smic. Ces situations de « non-conformité » renvoient aux difficultés rencontrées par les employeurs et les syndicats pour parvenir à des accords dans des délais raisonnables, au niveau des secteurs d’activité. Parfois, il y a même des blocages structurels, comme dans le monde de la prévention-sécurité, dont la grille affiche trois niveaux de salaire en dessous du SMIC, selon la direction générale du travail.
« Occasion manquée »
Dans ces cas, les chefs d’entreprise sont toujours tenus de payer le minimum légal à leur personnel, mais les travailleurs, situés dans les premiers coefficients des conventions collectives, peuvent se retrouver payés au SMIC, qui a été revalorisé, faute de discussion entre les partenaires sociaux pour améliorer les réseaux.
Le projet de loi tente de corriger ces anomalies : désormais, les retardataires peuvent être fusionnés avec d’autres si leur convention collective ne respecte pas le minimum légal. Le but est de « inciter à négocier » et « de s’assurer de la conformité de leurs minima au salaire minimum »indique l’exposé des motifs au texte.
De nombreux députés ont jugé cette innovation très timide, lors des débats en commission des affaires sociales, mercredi 13 juillet. François Ruffin, élu La France insoumise de la Somme, y a vu « une façon de se décharger de nos responsabilités et de ne pas les prendre »résumant l’état d’esprit de nombre de ses pairs de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale.
Il vous reste 38,13% de cet article à lire. Ce qui suit est réservé aux abonnés.
[ad_2]
Source link