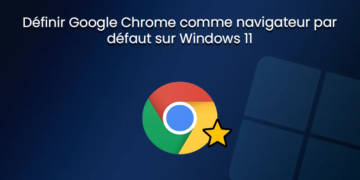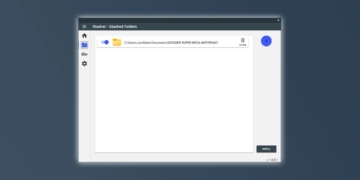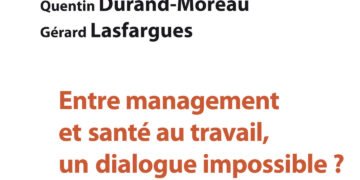[ad_1]
Cinq ans après avoir éclaté, la « bataille des prud’hommes » fait encore des étincelles. La cour d’appel de Douai vient de raviver la flamme de la rébellion contre une mesure phare du premier mandat d’Emmanuel Macron : l’encadrement des dommages et intérêts que la justice accorde aux salariés victimes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. . Les magistrats du Nord, dans un jugement rendu le 21 octobre, ont rejeté cette disposition, car elle « ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée » du préjudice subi par un homme employé dans une entreprise de nettoyage. La décision attire l’attention car elle contredit les plus hautes juridictions de notre pays.
A l’origine de la polémique, il y a un barème mis en place par les ordonnances de septembre 2017 qui ont réécrit le code du travail. Elle se présente sous la forme de grilles de rémunération, avec des planchers et des plafonds qui varient selon l’ancienneté du salarié et la taille de son entreprise.
Bien qu’elles aient reçu le feu vert du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, ces règles ont été contestées devant les tribunaux, au motif qu’elles ne prévoient pas toujours d’indemnisation « adéquat » à la personne licenciée abusivement par son patron. Il s’agit pourtant d’un principe inscrit dans des textes auxquels la France a souscrit : Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et Charte sociale européenne.
« Circonstances spéciales »
Dans plusieurs contentieux, les prud’hommes, puis les cours d’appel, se sont affranchis du barème et ont accordé aux plaignants des sommes supérieures à ce qui était prévu par celui-ci. A l’appui de leur décision, ces juridictions se sont appuyées sur la convention de l’OIT et la Charte sociale européenne. La querelle a duré plusieurs années. Saisi par la CGT et Force ouvrière, l’OIT s’en est aussi mêlée : dans un rapport publié fin mars, une de ses autorités écrit que le barème pourrait ne pas assurer le bon niveau de protection et invite les autorités françaises à l’évaluer à à intervalles réguliers, pour envisager d’éventuelles améliorations.
Après de nombreux rebondissements, la Cour de cassation a validé le mécanisme, d’abord dans un avis en 2019. Puis, dans des arrêts rendus le 11 mai 2022, elle a estimé qu’il respectait les engagements internationaux de la France et que les tribunaux devaient s’y conformer. , au nom du principe d’égalité, afin d’éviter les dérives d’un droit appliqué à la carte.
Il vous reste 59,82% de cet article à lire. Ce qui suit est réservé aux abonnés.
[ad_2]
Source link