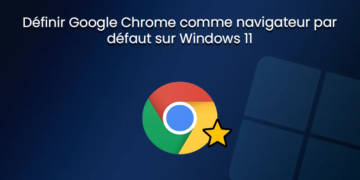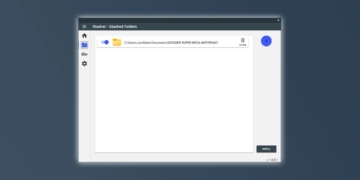[ad_1]
Tribune. La petite enfance est une étape clé du développement cognitif, social et émotionnel, ainsi que de la croissance et de la santé. De fortes disproportions socio-économiques existent dès les premiers jours de la vie dans presque tous les pays. La France n’échappe pas à cette inégalité. Jusqu’à récemment, peu de recherches avaient été menées sur ce sujet en raison de l’absence de grandes enquêtes nationales représentatives sur les jeunes enfants qui tiennent compte du milieu social, de la santé et du bien-être des enfants. L’Etude longitudinale française de l’enfance (Elfe), qui a inclus plus de 18 000 enfants nés en 2011, a fait plusieurs constats.
Elle montre que malgré un filet de sécurité familial généreux, les disparités socio-économiques de santé et de développement sont très visibles en France dès la naissance. Par exemple, les ménages les plus défavorisés sont plus à risque de prématurité ou de faible poids à la naissance. Cela se voit dans le développement de la parole. Alors qu’en moyenne, à 2 ans, les enfants connaissent 74 mots sur une liste de 100 mots proposés, ceux dont la mère a un niveau de compétence inférieur au BEPC en savent 4 de moins, et ceux dont la mère est titulaire d’un baccalauréat + 2 diplômes ou plus en connaissent 6 Les disparités en matière de santé mentale sont mesurées vers l’âge de 5 ans, les enfants défavorisés étant plus à risque de difficultés socio-émotionnelles.
Quels mécanismes génèrent ces inégalités et comment les corriger ? La politique du plan quinquennal actuel est principalement basée sur la prise en charge des enfants en dehors de la famille et sur l’éducation précoce. Depuis 2019, l’âge de la scolarité obligatoire a été abaissé à 3 ans (au lieu de 6) avec l’objectif théorique de réduire les inégalités sociales dès le plus jeune âge. L’une de ses actions phares dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté est de favoriser l’accès aux crèches pour les plus vulnérables, notamment par la création d’une prime mixte favorisant la mixité sociale et un plan de formation des professionnels de la petite enfance.
Ces politiques fonctionnent-elles ? Réduisent-elles les inégalités dans la petite enfance ? Bien que, malheureusement, nous manquions encore d’évaluations directes de ces mesures, nos recherches suggèrent que oui, mais seulement jusqu’à un certain point.
Facteurs clés
Le développement du langage, par exemple, chez les enfants diffère selon le mode de garde utilisé. Les enfants de la crèche ont acquis un vocabulaire plus riche que leurs parents ou leurs grands-parents, surtout chez les enfants les plus défavorisés. Les interactions avec les professionnels de la petite enfance qui proposent des cours adaptés peuvent être source d’enrichissement du vocabulaire. Ainsi, les méthodes d’acceptation collective peuvent devenir un moyen de réduire les inégalités. Mais ces modes d’admission sont encore inégalement répartis tant géographiquement que socialement, puisqu’ils sont accessibles en priorité aux parents dans leurs activités professionnelles et peuvent engendrer des frais (même s’ils sont souvent modulés par les revenus).
Il vous reste 48,98% de cet article à lire. De plus uniquement pour les abonnés.
[ad_2]
Source link